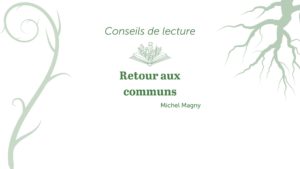La forêt n’est pas épargnée par la pollution. En Europe, celle aux métaux lourds est particulièrement marquée.
Thibaut Rota
« Les questions environnementales et de santé humaine sont liées. »
Dans nos représentations, les forêts sont plutôt considérées comme relativement préservées des conséquences de l’activité humaine. Pourtant, comme la totalité des écosystèmes terrestres et aquatiques sur la planète, elles n’y échappent pas, y compris dans les espaces où l’anthropisation est limitée.
En 2024, six chercheurs ont mené une étude sur les forêts anciennes, notamment dans la forêt de la Massane, hêtraie en libre évolution depuis 150 ans. Nabil Majdi, Manuel Henry, Dominique Aubert, Andreas Bruder, Martin Gossner et Thibaut Rota se sont penchés sur les dendrotelmes, cavités dans les troncs d’arbres où se déposent des sédiments, ce qui permet de situer dans le temps les pollutions. Thibaut Rota, qui travaille plus spécifiquement sur les métaux lourds, a répondu à nos questions.

Quel type de pollutions aux métaux lourds trouve-t-on en forêt ?
Thibaut Rota : Jusque dans les années 1990, où la prise de conscience des conséquences sur la santé de l’usage du charbon et des carburants au plomb a conduit à une réglementation, on trouvait de forts taux de plomb dans l’atmosphère. Il s’agit d’un élément neurotoxique, occasionnant des troubles tels que le saturnisme. Certains scientifiques étudient ses effets sur la baisse du QI, voire l’augmentation des taux de criminalité. Les pluies acides ont aussi libéré l’aluminium dans le sol, le rendant disponible pour les plantes, ce qui a causé pas mal de soucis. Les questions environnementales et de santé humaine sont liées. Malgré la diminution globale de la pollution atmosphérique, elle reste le principal risque environnemental pour la santé en Europe. Les écosystèmes à côté de chez nous sont nos sentinelles. Une forêt est bien plus résistante que des bipèdes : si elle commence à crever, on peut se poser des questions…
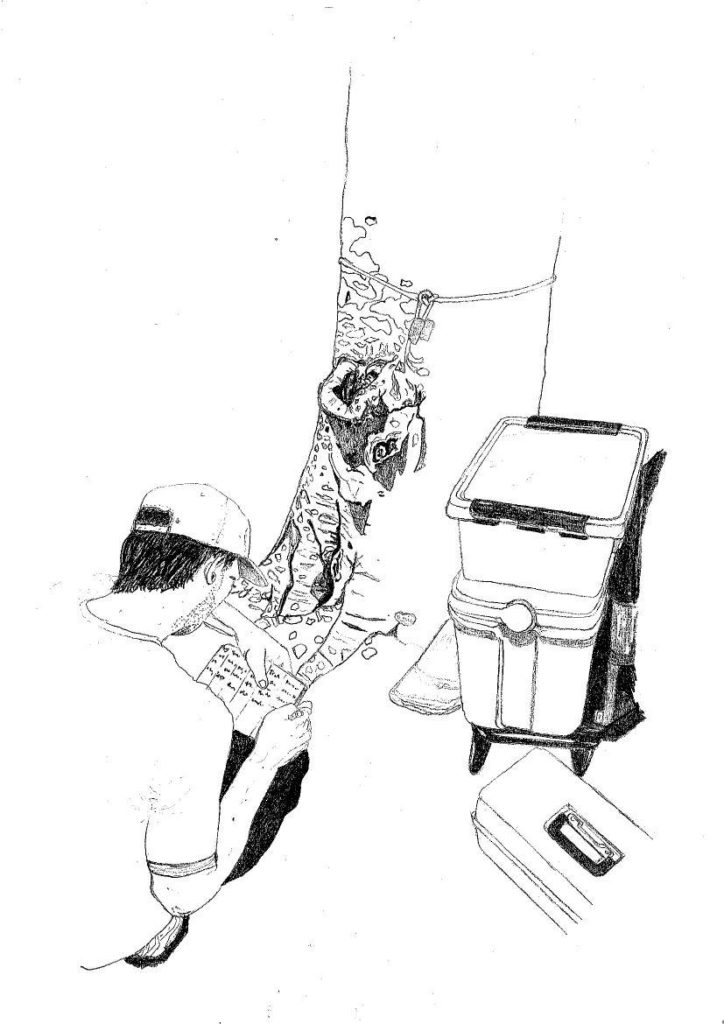
Ces pollutions arrivent en forêt par les airs ?
Oui. De fait, quand on s’intéresse à la pollution atmosphérique, il est utile d’étudier les zones forestières en amont des bassins versants. L’arbre est détaché du sol, à l’interface avec l’atmosphère. On peut utiliser les lichens, les mousses, qui intègrent les polluants atmosphériques dans leurs tissus ou leur surface, puis les excrétent, comme des éponges. Ou bien faire des carottes dans les arbres, en essayant d’avoir toutes les stries et d’aller jusqu’au cœur du tronc, pour reconstituer des séquences temporelles. Les métaux lourds sont persistants. Nous avons comparé leur présence sur la Massane, et deux forêts en Suisse, le Silhwald et Morcote, avec des secteurs en Amazonie. L’air y est bien moins pollué qu’en Europe, mais il y a là-bas d’autres problématiques, localement, la forte présence de mercure liée aux activités minières des chercheurs d’or, par exemple. Et quand la forêt brûle, cela peut occasionner une concentration des métaux lourds, lorsqu’ils se redéposent. Ils peuvent être toxiques à faible dose.
Toute la chaîne trophique est alors atteinte, jusqu’aux hommes qui consomment les animaux. Il y a plus de précipitations aussi : la pollution se répand avec l’eau.
À propos d’eau, vous avez étudié celle qui s’accumule dans le creux des arbres. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les dendrotelmes ?
Il s’agit d’une petite vasque qui se forme entre les fourches, ou au niveau d’anciennes blessures, lorsque l’arbre a perdu une branche…. On peut trouver jusqu’à 60 litres d’eau dans un gros hêtre de la Massane. Des matières organiques comme les feuilles s’y accumulent. Certains organismes, insectes, arthropodes, sont spécialisés de ces habitats. Les forêts anciennes y sont propices : plus elles sont vieilles, plus il y a de cavités ! Dans la forêt amazonienne, on en trouve des centaines, voir des milliers par hectare, alors que c’est plus rare dans les forêts secondaires européennes.


Deux dendrotelmes formés naturellement dans la forêt de La Massane © Association Francis Hallé pour la forêt primaire
C’est intéressant à étudier, car les arbres captent la pollution atmosphérique par leurs branches, leur feuilles, et ces éléments percolent le long du tronc jusqu’aux cavités. Le processus est sédimentaire : des couches se déposent, comme dans les lacs, cela donne la possibilité de remonter dans le temps. De plus, nous pouvons tester directement les effets des polluants sur les organismes aquatiques présents.
Qu’avez-vous constaté, en comparant vos différents terrains ?
Le site de Morcote, au sud de la Suisse et au Nord de l’Italie, est le plus pollué de ceux que nous avons étudié en Europe. Il est à proximité de la ligne Lyon-Turin, avec énormément de poids lourds en circulation, et c’est un secteur très industrialisé, proche du Pô. Nous nous sommes concentrés sur huit éléments seulement : Vanadium, Nickel, Zinc, Cadmium, Chromium, Cuivre, Arsenic et Plomb. Parce qu’on les trouve en concentrations relativement importantes, et parce qu’ils sont connus pour être toxiques. Les effets cocktails ne sont pas évidents à évaluer, cela demanderait des études plus poussées, mais mon feeling est que l’on pourrait identifier bien d’autres éléments en élargissant les analyses. Du DDT, tous les pesticides et autres produits rémanents… On les aurait sûrement trouvés si on les avait cherchés dans ces dendrotelmes.
Ce projet de recherche a duré un an, donc un temps assez court, mais il faudrait aller plus loin, avec d’autres spécialistes : la chimie des métaux et la chimie organique est différente, ce ne sont pas les mêmes machines qui sont utilisées. C’est cependant un bon début de commencer avec les métaux.
Quelles sont vos conclusions ?
Il y a bien plus de polluants en Europe. Dans des concentrations alarmantes, pour qu’elles soient seulement dues à de la pollution atmosphérique de moyenne et longue distance, et ce dans des forêts protégées de toute activité humaine directe, sans coupe récente ou motorisation. Notamment en ce qui concerne le plomb : jusqu’à 750 microgrammes par gramme de sédiments secs. Les particules fines qui contiennent ces éléments arrivent à l’état solide via les flux d’air, ou déjà dissoutes par les précipitations. Elles se fixent aux feuilles, et ruissellent jusqu’aux cavités. Cela ne veut pas dire que toute la forêt est impactée à ces niveaux-là ; un arbre, c’est une surface fractale, exponentielle, avec toutes ses branchettes, représentant un volume énorme, qui produit un effet entonnoir. Raison d’ailleurs pour laquelle on recommande de planter des arbres en ville : pas seulement pour lutter contre la chaleur, mais aussi pour leur effet de filtre.

Il reste du plomb dans l’atmosphère, malgré l’interdiction dans les carburants ?
Avec mon collègue Nabil Majdi, nous avons étudié des relevés contemporains : il en reste bien.
À la Massane, de l’ordre de 116 grammes de plomb par hectare et par an. Même si le taux diminue grâce aux efforts de réglementation, il y a toujours une pollution très active. Très spécifiquement sur ce site, le problème est l’autoroute A9, à 10 kilomètres, avec son énorme circulation de voitures et camions. Cela montre bien que construire une route n’a pas seulement un impact local, avec des arbres coupés sur le tracé, mais aussi diffus dans les écosystèmes alentour, à l’échelle régionale, nationale, voire continentale, suivant les vents. La pollution est certes plus forte localement, le plus gros va se redéposer, mais elle se répand sur de longues distances, comme le panache des incendies. C’est valable pour les métaux lourds, et aussi tout le reste, les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) issus de la combustion, très nuisibles, stabilisateurs de pneus, diverses molécules, plastiques, poussières… Tout un cocktail contribuant au pool de polluants atmosphériques.
Il est très intéressant d’étudier ainsi l’évolution dans le temps, en fonction des activités humaines, du changement climatique… La forêt est une mémoire vivante. Cela montre bien que la réglementation change les choses.
Oui. Sur nos relevés, nous observons des courbes en cloche, en fonction de la taille des arbres. Les plus gros sont plus pollués que les petits, mais parfois moins que les moyens, car la pollution n’est pas constante dans le temps. Nous avons carottés les sédiments dans les gros dendrotelmes, comme on peut le faire dans les tourbières ou un lac : le pic en Europe est sur la période 1975-1995. La plus grosse carotte mesurait 26 centimètres, que nous avons découpés en tronçons de 1,5 centimètres et envoyés dans un laboratoire de spectrométrie gamma, qui analyse la radioactivité. Ils ont déterminé l’activité au Césium 137 et au Plomb 210, des radioéléments utilisés pour dater les sédiments. On y voit le pic de Tchernobyl. Certains seuils sont proches de ceux fixés par l’Europe pour la consommation des aliments. D’autres dépôts de radioactivité, plus anciens, semblent liés aux essais nucléaires dans le Sahara, dans les années 1960.
Les courbes en cloche peuvent donner l’impression qu’il y a du mieux, les taux baissent, mais cela ne signifie pas pour autant que tout va bien.
En effet ! Le message est : plus on laisse du temps passer sans réglementer, plus cela s’accumule. Les pollutions peuvent baisser avec le temps, mais celles des périodes précédentes ne disparaissent pas. On ne peut pas dépolluer une forêt. Une partie des polluants va certes être lessivée, mais cela déplace le problème dans la vallée ou les nappes phréatiques. Le plomb, par exemple, s’attache aux matières organiques, qui vont être mangées par un champignon ou une bactérie, puis par des insectes, oiseaux, etc., avec un effet toxique sur l’ensemble de la chaîne trophique.
Les polluants s’accumulent dans les dendrotelmes. Or ce sont des cavités beaucoup utilisées par les animaux, qui viennent y boire. En six mois, à la Massane, nous avons filmé des genettes, écureuils, martres, merles, grives communes, sitelles, lézards, souris… C’est une forêt méridionale, les animaux ont soif et viennent y boire quand les cours d’eau sont asséchés, comme c’est de plus en plus souvent le cas. Les problématiques convergent, entre la pollution atmosphérique et la sécheresse.
Propos recueillis par Gaëlle Clorarec le 30 juillet 2025
Photo de couverture : Réserve naturelle nationale de la Massane © Pierre Chatagnon